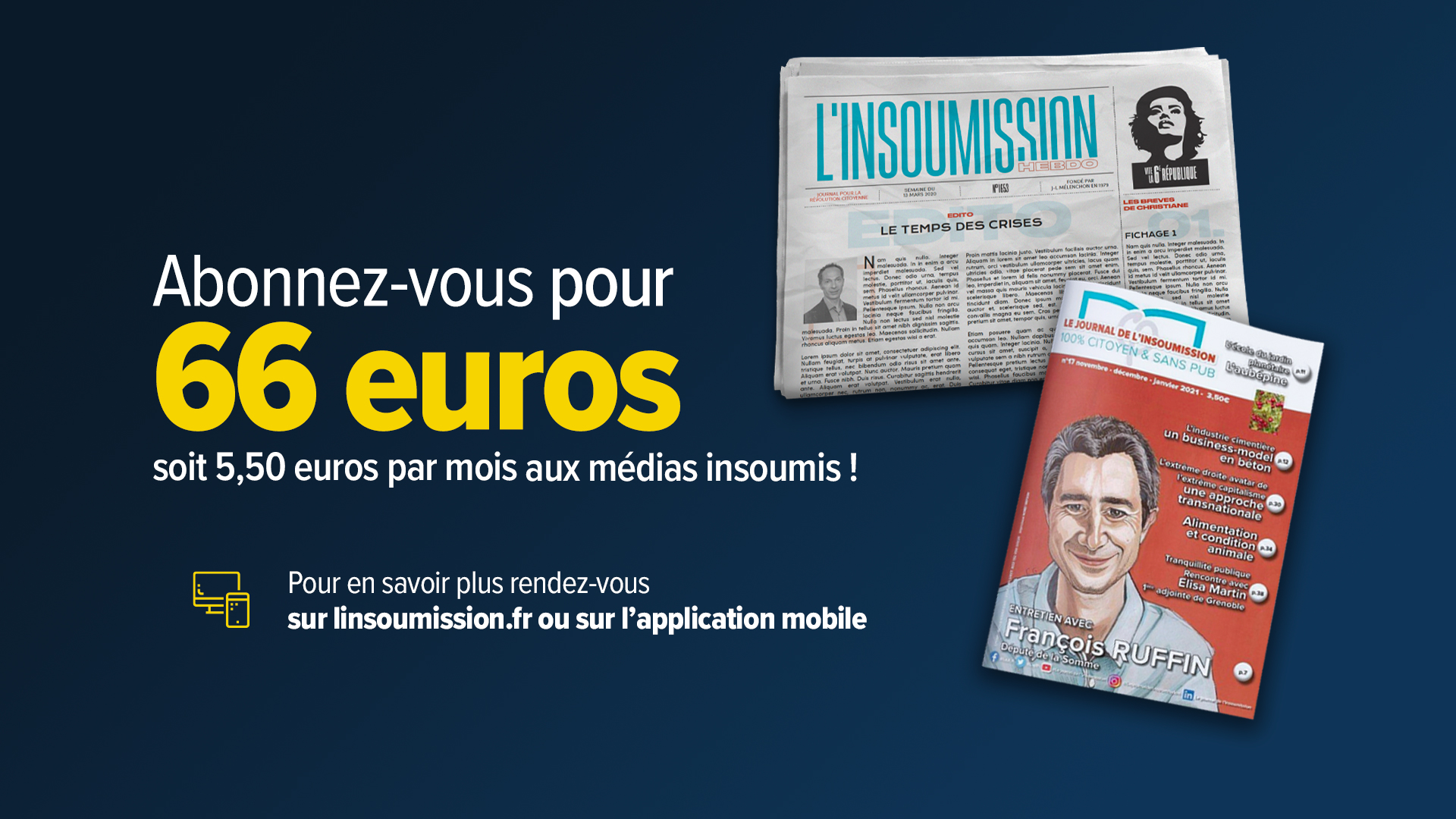L’Insoumission.fr publie un nouvel article de sa rubrique « Nos murs ont des oreilles – Arts et mouvement des idées ». Son but est de porter attention à la place de l’imaginaire et de son influence en politique avec l’idée que se relier aux artistes et aux intellectuels est un atout pour penser le présent et regarder le futur.
Chien Blanc. Le film produit par Nicole Robert et adapté du roman de Romain Gary aborde la persistance du racisme, de Martin Luther King à George Floyd et Black Lives Matter. Le film retrace l’histoire vraie de Gary et Jean Seberg, impliqués dans les droits civiques des Noirs américains. Un après-midi, un chien errant apparaît dans la villa californienne de Romain Gary qui décide de le garder. Au grand désarroi de son nouveau maître, le chien se révèle être un chien blanc, c’est-à-dire dressé à attaquer spécifiquement les Noirs. Symbole des tensions raciales et sociales.
La réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette examine l’engagement et l’écriture, tout en soulignant l’importance de la démocratie et de la lutte pour l’égalité. Notre article.
De Martin Luther King à Black Lives Matter

« La mort de George Floyd et le mouvement « Black Lives Matter » nous confrontent encore au racisme à l’égard des Afro-descendants. Ce monde meilleur dont parlait Robert Kennedy, dans son discours où il annonçait au monde entier l’assassinat de Martin Luther King, est, plus de 50 ans plus tard, encore à bâtir. » C’est en ces termes que la productrice Nicole Robert explique ce qui l’a motivée à produire ce film adapté du roman de Romain Gary, Chien Blanc, écrit en 1969, pendant les grandes émeutes raciales aux États-Unis.
Le film Chien Blanc s’ouvre d’ailleurs sur le discours prononcé à Indianapolis en 1968, par le sénateur Robert Kennedy, après la mort du pasteur Martin Luther King. Ce discours pacifiste marquera la fin d’une solution pacifique aux conflits raciaux aux USA. Après cet évènement, le mouvement « Black Panther Party » sera au premier plan avec des actions et des manifestations d’un autre ordre pour faire reconnaître les droits des Afro-Américains.
Si la lutte est politique, la seule réponse donnée aux Noirs est la répression totale, débouchant sur la révolte. Romain Gary commente ainsi cette situation : « Comment pouvez-vous vous étonner qu’un jeune Noir d’un ghetto (…) se mette à briser des vitrines. Mais non, c’est un cri, une réponse. » Comment ne pas y voir un parallèle avec les révoltes et les pillages au moment de la mort de George Floyd.
Chien Blanc, un roman sur le racisme inspiré d’une histoire vraie
Chien Blanc est en grande partie inspiré de la vie de l’écrivain Romain Gary. À cette époque, l’auteur est marié à l’actrice américaine Jean Seberg, célèbre pour son rôle dans « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard, et vit à Hollywood en Californie. L’actrice est déjà très engagée aux côtés des Noirs américains pour la reconnaissance de leurs droits civiques. Que raconte le roman ? Un après-midi, un chien errant apparaît dans la villa californienne de Romain Gary qui décide de le garder. Au grand désarroi de son nouveau maître, le chien se révèle être un chien blanc, c’est-à-dire dressé à attaquer spécifiquement les Noirs.
Ne pouvant se résoudre à le faire euthanasier car son fils s’est attaché à l’animal, Romain Gary décide, avec l’aide d’un Noir, Keys, dresseur canin professionnel, de rééduquer le chien. Cette décision va mettre en péril sa relation avec sa femme Jean Seberg, militante très active au sein des Black Panthers.
Peut-on faire sienne une cause qui ne nous appartient pas ?
« Ayant beaucoup voyagé, ayant beaucoup filmé et adhéré à la douleur des autres, je me suis souvent posé cette question : à quel point un conflit, une guerre, une douleur, qui ne nous appartient pas peut-elle devenir la nôtre ? C’est une des questions que soulève Chien Blanc. » comme nous l’explique la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette.
Comment peut-on faire sienne la cause d’un autre ? C’est tout le dilemme de Jean Seberg, engagée dans le combat anti-racial mais qui, en raison de sa notoriété, se retrouve piégée et utilisée par les médias qui reportent leur attention sur elle et occultent ainsi le véritable combat des Noirs, en les montrant en arrière-plan à l’image et en ne leur donnant jamais la parole.
Pour filmer avec justesse et fidélité une telle scène, la réalisatrice a été épaulée par deux conseillers afro-américains, Maryse Legagneur et Will Prosper, eux-mêmes cinéastes et militants qui ont veillé tout au long du film au respect de la représentation historique des faits et à la parole de la communauté noire. Ce dispositif reposant sur le dialogue et l’échange entre deux communautés tout au long du film est tout à fait innovant sur un tournage et prouve l’intégrité de la réalisatrice dans son propos. Elle a affirmé « une volonté d’inscrire le fond en accord avec la forme » et « le désir très concret de faire craquer un système figé ».
En tant que documentariste reconnue, elle a tenu à intégrer dans le film des images d’archives de ces émeutes et à montrer de face les visages des Afro-Américains afin de ne jamais les invisibiliser. Ces visages qui vous regardent en face apportent une force particulière au propos.
L’utilisation qu’elle a faite des images d’archives dans son film est particulièrement pertinente. On y voit, non sans malaise, ces fameux « chiens blancs » en train d’attaquer les Noirs pendant des émeutes. Et l’effet obtenu est saisissant car il nous rapporte à toute l’ambiguïté du film et à la position des trois protagonistes Jean Seberg, Romain Gary et Keys le dresseur du chien, par rapport à l’animal et ce qu’il représente.
Écriture et engagement
Dans ce récit se raconte aussi la fin d’un couple amoureux et anticonformiste mais que ses divergences de point de vue sur l’animal et sur l’engagement politique vont peu à peu éloigner. Jean Seberg ne comprend pas qu’on veuille sauver un chien agressif envers les Noirs (« Il est raciste, ton chien. Il faut le tuer. ») tandis que Romain Gary veut donner une chance à l’animal (« Alors on tue tous les racistes et puis après on élimine tous ceux qui ne pensent pas comme nous. »).
Dans la relation de Romain Gary et de son chien se pose aussi la question de notre rapport aux animaux. Pour l’écrivain, « une vie c’est une vie » et il pose la question qui divise beaucoup de monde dans la société « En quoi sa vie n’est pas égale à la tienne ? » Reconnaitre que les animaux sont des êtres sentients est une notion qui anime et divise encore aujourd’hui et elle est sous-jacente dans le conflit entre l’écrivain et sa femme.
L’incompréhension du couple va aller grandissante, les tensions sociales venant s’ajouter aux tensions sexuelles. Et cette incompréhension finira par les séparer. Pourtant celui qui essaie de changer les choses et cherche une issue humaniste à ces affrontements raciaux c’est Romain Gary. « Je fais encore confiance aux hommes même si ça semble absurde, même si on se fout de ma gueule. Il est plus grave de perdre que de se perdre. Je refuse de céder à l’escalade moderne de la désensibilisation. Autrement je meurs. »
Malgré son implication et ses convictions sincères, Jean Seberg sera écartée d’un combat que les Noirs veulent se réapproprier. Et elle le vivra comme un échec et un drame personnel.
Au centre du roman se trouve aussi la question de l’engagement et de l’écriture. Deux formes d’engagement se confrontent dans le film, celui du militantisme avec Jean Seberg et celui de l’écriture avec Romain Gary. Car les deux protagonistes diffèrent sur les moyens utilisés.
Pour Romain Gary, il faut partir de sa propre condition « Si je devais écrire un livre, ce serait d’abord pour questionner ma place d’homme blanc dans ce combat pour l’égalité. » Pour Jean Seberg, il faut adhérer à la cause et s’impliquer dans l’action. Mais pour Romain Gary « tout est dans la façon de se battre ». Le débat reste entier après la vision du film car Anaïs Barbeau-Lavalette n’impose pas son point de vue et reste à l’écoute.
À plusieurs reprises, la réalisatrice filme la course d’enfants noirs poursuivis par un chien blanc à travers le temps. On voit d’abord les jambes d’un jeune esclave aux vêtements déchirés, puis celles d’un jeune écolier et d’une jeune fille noire en tennis dans les années 60 puis, de nos jours, celles d’un jeune Noir qui porte un modèle actuel de baskets.
À travers le fil rouge de cette fuite ininterrompue, le film redit bien à quel point ce roman écrit au moment de la ségrégation interroge encore et à quel point, à travers ce film, la question du racisme reste d’actualité. Citons cette phrase de James Baldwin, écrivain noir (1924-1984) mise en avant par la réalisatrice, au début de son film « L’histoire n’est pas le passé. L’histoire est maintenant. Nous la portons en nous, nous sommes notre histoire. »
Il existe une autre adaptation du roman : « Dressé pour tuer » de Samuel Fuller (sortie 1982) qui va ressortir chez ESC Éditions en vidéo le 18 septembre.
Par Carlotta Fontaine